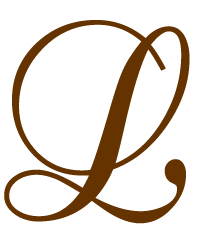Jean Lauxerois Questions de Tudor Petcu à propos de l’orthodoxie
Jean Lauxerois
Questions de Tudor Petcu à propos de l’orthodoxie
*
1/ Vous qui êtes catholique, comment avez-vous découvert l’orthodoxie ? Quels sont les représentants de l’orthodoxie que vous avez les uns rencontrés, les autres découverts ? Et pourquoi l’orthodoxie est-elle aujourd’hui importante à vos yeux ?
La chance, ou la grâce, a voulu que ma découverte de l’orthodoxie ne se fasse pas d’un coup, comme une brusque révélation, mais au contraire par étapes, et comme par stratifications, dont je puis dire rétrospectivement (en un processus proustien) que chacune a eu son importance en préparant la suivante, selon un cheminement qui s’est accompli presque malgré moi. Le point de départ, et le socle, c’est ma connaissance du grec ancien et ma formation philosophique. La suite, c’est avant tout ma rencontre de la Roumanie et la richesse de ce qu’elle continue de me révéler.
Apprendre le grec ancien a été pour moi une bénédiction, je l’ai su après. Cette langue époustouflante est une langue de pensée comme il n’en existe pas d’autres à mon humble connaissance. J’ai pu le mesurer dans ma formation philosophique, quand un grand professeur, tout en nous initiant à Heidegger, nous faisait saisir la dimension directement phénoménologique de la langue grecque. La « rupture inaugurale », ce furent donc ces deux ouvertures corollaires, celle de la pensée de Heidegger – avec les multiples questions qu’elle posait déjà pour moi : entre mille, et pour faire bref ici, la notion d’onto-théologie, la question de Dieu et de l’être, la dimension du négatif – et celle de la pensée grecque, qui ne se limite pas à la seule philosophie, parce qu’elle est d’abord à l’œuvre dans la poésie et dans la tragédie. Sur cette base initiale – qui demeure à l’horizon de mon travail d’aujourd’hui – j’ai pu assez tôt, et sans idée préconçue à l’époque, découvrir les enjeux philosophiques et théologiques de la latinisation du grec, donc l’importance de la traduction dans la tradition ; j’ai pu également commencer à lire Denys, Origène, Plotin et quelques Pères grecs. J’ai assez vite entrevu combien le christianisme de ces Pères brillait d’un éclat particulier, irréductible à ce qui m’avait été transmis par la tradition augustinienne – même si déjà j’inclinais davantage vers saint Jean de la Croix et vers Maître Eckhart. Même si ma lecture restait encore partielle, et sans doute aveugle, lire les Pères grecs était une singularité, dans la mesure où ce n’était pas une habitude très répandue en France : en tout cas, cette lecture a accompagné mes premières interrogations sur le christianisme et sur la séparation de Byzance et de Rome, comme elle a bien sûr contribué à préparer mes futures découvertes.
Ma rencontre avec la Roumanie a mis du temps à advenir, mais elle a été l’événement qui a permis la maturation et l’accomplissement de tout ce qui avait précédé. Deuxième « grâce » sans nul doute, quand, voici seize ans, mon mariage avec Catherine Imbert, pianiste, m’a ouvert les portes d’un monde nouveau. Non certes immédiatement. Là encore en strates successives. Par sa famille maternelle (Poenaru-Bordea), ma femme avait une grand-mère roumaine en exil, qui l’avait bercée de l’amour de son pays natal et de la poésie d’Eminescu ; elle lui avait insufflé la passion de la Roumanie et de son histoire, dont elle continue à recueillir les traces en collectionnant les livres roumains, dans une bibliothèque qui, vraisemblablement, a peu d’équivalent aujourd’hui. C’est mon épouse, catholique elle-même, qui m’a parlé la première du Journal de la Félicité, du Père Nicolas Steinhardt, livre qui l’avait profondément marquée et qu’elle m’a conseillé.
Notre mariage fut l’occasion d’un premier voyage à Bucarest, et pour moi du premier contact avec la Roumanie. Quelques années passèrent. Les recherches généalogiques menées par mon épouse l’ont alors conduite à revenir sur le terrain, et à mettre assez récemment au jour que ses ancêtres avaient « fondé » trois églises (à Bucarest, à Călăraşi et vers Slobozia, où a été rapatriée, voici quelques années, la belle église de bois sise autrefois à Poiana). C’est dans ce moment-là, voici environ sept ans, que tout s’est accéléré dans la rencontre des lieux et des êtres, et que tout s’est magiquement imbriqué. Au nombre des êtres, je dois beaucoup à Pia Paleologu, à laquelle mon épouse est apparentée. Femme de grande foi, merveilleuse aquarelliste, d’un sens artistique extrême et d’une généreuse humanité, Pia Paleologu, sachant mon amour de la peinture, m’a permis de rencontrer, en 2009, des Roumains qui ne ressemblaient à rien de ce que j’avais pu connaître non seulement en Occident, mais dans le monde en général : des artistes qui étaient aussi et simultanément des êtres de foi incarnée (c’était donc possible !), des êtres avec lesquels je me suis senti en prise immédiate – telle Silvia Radu, magnifique sculpteur, qui a fondé église et monastère, qui m’a fait connaître l’œuvre exceptionnelle de son mari, le sculpteur Gorduz (je ne l’ai malheureusement pas connu), et qui me nourrit régulièrement de son expérience profonde de la foi orthodoxe ; j’ai également rencontré Sorin Dumitrescu, avec lequel j’ai pu nouer un substantiel dialogue, roulant sur l’art, sur la poésie et sur la théologie. Dans ce sillage, en compagnie de nos cousins Poenaru-Bordea, de Bucarest, ma femme et moi avons fait en 2010 le voyage jusqu’aux monastères de Moldavie. Inutile de vous dire pourquoi la découverte de Probota, Sucevița, Moldovița, Voroneț et tous les autres fut l’un des chocs de ma vie. Jamais je n’avais imaginé pareille réalité – architecturale, picturale, théologique. Ce sont ces monastères (et j’ajouterai la poésie d’Eminescu) qui m’ont décidé à apprendre votre belle langue roumaine, que j’essaie de travailler depuis cinq ans maintenant.
Ma connaissance de l’orthodoxie s’est alors vite enrichie. Pour les hauts-lieux, il y eut, après la Moldavie et la Bucovine, un pèlerinage pascal au monastère de Lupşa, en 2012, dans les monts Apuseni (pèlerinage organisé en France par la patriarchie de l’Eglise roumaine de France) : ces Pâques à Lupşa furent pour moi l’occasion de saisir l’importance majeure des monastères dans l’orthodoxie et dans la vie de la Roumanie – réalité qui est sans équivalent en Occident. Autre voyage bouleversant, celui que nous avons entrepris de faire dans le Maramureş en 2013, voyage à pied pour l’essentiel, qui m’a révélé combien au cœur des villages et leurs églises de bois vivait une foi que j’appelle « à ciel ouvert » ; cette foi impressionnante était d’ailleurs la même chez les gréco-catholiques, dont l’accueil était toujours émouvant, tel celui de cette paysanne nommée Lenuta qui nous dit à propos de la mort : « Si on ne croit pas, la route vers la lumière ne s’ouvre pas. » Sur la porte de son église, comme sur toutes celles du Maramureş, et sans doute de Roumanie, était alors placardé le visage admirable de celui dont était annoncée la béatification, Monseigneur Ghika (auquel notre famille roumaine était apparentée).
Dans cette région bénie, j’ai pu faire l’expérience concrète de la foi orthodoxe quand à Botiza nous avons fait la connaissance du Père Isidor Berbecaru, homme de Dieu s’il en est : c’est grâce à lui que nous avons découvert la spiritualité profonde de son Maramureş, c’est avec lui, par exemple, que nous avons pu participer à la fête d’un hram pour la Nativité de la Vierge – et en cette occasion, j’ai rencontré un homme étonnant, Hotico, un artisan au sens médiéval du terme, qui m’a parlé à merveille de l’architecture des églises de bois qu’il construit dans le monde entier. Le Père nous a même conduit jusqu’au petit village de Vişeu de Sus, sur les marges lointaines de la Roumanie profonde, pour rencontrer les parents du Métropolite Joseph, le représentant de l’Église orthodoxe roumaine en Europe occidentale, dont nous avions fait la connaissance à Paris plusieurs années auparavant.
Du Maramureş à Paris il n’y a qu’un pas, puisqu’Hotico a aussi construit une église de bois dans le jardin de la patriarchie de Limours, à la tête de laquelle rayonne sur l’Europe entière l’impressionnante présence spirituelle du Métropolite Joseph, insufflant à son Église une énergie assurément divine. Parmi les pères de cette Église, j’ai eu la joie de rencontrer le Père Marc-Antoine de Beauregard, joie mêlée de surprise, car nous avions été condisciples dans nos premières années d’études ; nous nous étions perdus de vue, et voilà que je le retrouvais plus de quarante après lors d’une conférence : l’étudiant de philosophie était devenu orthodoxe, puis avait fait un an d’études théologiques à Bucarest, où il avait rencontré le Père Staniloae, pour être finalement ordonné prêtre de l’Église roumaine ! Nos chemins se croisaient à nouveau, grâce à l’orthodoxie et à la Roumanie. C’est lui qui m’a encouragé à lire le Père Staniloae, avec lequel il a écrit un livre d’entretiens et dont il traduit l’œuvre en français. Autre belle rencontre sous le signe de l’orthodoxie, celle de Felicia Dumas, professeur à Iasi, que j’ai connue quand j’ai fait l’acquisition du dictionnaire franco-roumain/roumain-français des notions clefs de l’orthodoxie. Notre relation d’estime et d’amitié demeure essentiellement épistolaire, mais elle est marquée pour moi par la lumière diamantine de la foi de cette humble et grande roumaine ; c’est elle qui m’a engagé à lire le Père Placide Deseille, dont elle traduit les textes en roumain, et voilà qu’avec le Père Placide je retrouvais les Pères grecs, dont il est un traducteur et un commentateur très avisé. Mais j’ajouterai que bien des Roumains plus ou moins anonymes ont beaucoup contribué à me faire ressentir et à admirer l’orthodoxie vivante : ce sont notamment certains prisonniers politiques, dont la foi leur a permis de résister dans les prisons du communisme ; c’est encore telle vieille paysanne en prière à mes côtés pendant les longues heures de la nuit du samedi de Pâques à Lupşa ; c’est encore, et tout autant, Adela, la dame du Maramureş qui fait notre ménage à Paris : elle me raconte comment son récent pèlerinage à Jérusalem a transformé sa vie, m’apporte régulièrement des livres orthodoxes, me parle d’Arsenie Boca : elle est à mes yeux un exemple de la foi incarnée dans une extrême humanité.
En parallèle, et depuis plusieurs années, j’ai bien sûr repris la lecture des Pères grecs, notamment saint Basile, saint Maxime le Confesseur, saint Grégoire Palamas. Je me suis renseigné sur les figures des « grands spirituels » comme saint Silouane de l’Athos, le Père Paissié Olaru, le père Sophrony… Et j’ai lu des textes de Justin Popovici, de Vladimir Lossky, du Père Staniloae bien sûr, d’Edvokimov, ainsi que de Yanaras, de Romanides et de Rafael Noica (Cultura duhului – « La Culture de l’esprit »).
La question qui m’est parfois posée est évidemment de savoir pourquoi je ne deviens pas orthodoxe. Je réponds comme je le fais ici : je ne veux pas déclencher une guerre de religion à ma petite échelle ; l’orthodoxie me permet de mieux vivre mon catholicisme, avec lequel pourtant les relations n’ont pas toujours été très amicales… Je ne veux pas non plus abandonner la religion de mes pères, et surtout celle de mon grand-père, homme de grande foi, auquel je dois l’élan initial dans la pratique et la compréhension vivante du christianisme ; je ne veux pas être infidèle à tous les prêtres magnifiques que j’ai rencontrés dans ma vie, auxquels je dois tant et dont je sais combien ils souffrent dans la société occidentale contemporaine ; et je ne veux pas non plus délaisser les grands figures du catholicisme moderne qui me sont chères, entre autres Baudelaire, Bernanos, Simone Weil ; et puis je me dis qu’ainsi je peux vivre à ma façon la réalité concrète de l’Église indivise, qui compte aussi, côté occidental, ajoutons-le, de pures merveilles comme saint Irénée, les grands martyrs, sainte Geneviève, sainte Françoise (la patronne de Rome), les grands mystiques de la tradition, tel saint Jean de la Croix, ou encore Blaise Pascal…
Voilà pour ma découverte de l’orthodoxie et son importance pour moi. Une longue histoire, une expérience à l’échelle d’une vie, et une histoire encore ouverte, je l’espère de tout cœur.
2/ Pour vous, quel serait le sens majeur de la voie orthodoxe, et quel serait l’enseignement le plus important que vous ayez reçu de l’orthodoxie ?
Ma réponse sera abrupte, et non moins décidée : pour moi, le sens majeur de l’orthodoxie, c’est l’icône. Je ne voudrais pas ici passer pour un spécialiste de l’icône, que je ne suis pas et ne prétendrai jamais être. Pour éviter tout malentendu, je l’appellerai le sens de la dimension iconique, qui répond d’ailleurs, chez moi, à une intuition et à une expérience extrêmement ancienne (quasi d’enfance, même si je ne la nommais pas ainsi !) : c’est une évidence lumineuse, dont j’ai peu à peu compris ensuite, au fil du travail de la pensée et de ma compréhension de l’orthodoxie, qu’elle était en effet le cœur de la question.
Comme la plupart des mots décisifs de nos langues, « icône » est un mot qui parle grec. Mais pas seulement parce que l’étymologie le dit. Il parle grec en profondeur. Mais l’Occident a « oublié » son sens. L’Occident a gardé et surexploité le mot « idée », qui lui vient de Platon, mais il a perdu le mot « icône ». Certes, le terme est encore dans le dictionnaire, on l’utilise encore, mais de manière terriblement triviale et dévoyée (à la suite de son recyclage dans la malheureuse linguistique du XXe siècle, on parle couramment aujourd’hui d’une « icône de la mode, » d’une « icône des années 70 », dans une acception terriblement banalisante du terme). Dans l’histoire de la rupture entre l’Occident et l’Orient, de la déchirure du christianisme, tout se joue primordialement avec l’icône, avant même les querelles théologiques et « byzantines ». L’Occident, donc, bien que revendiquant son héritage « gréco-latin », selon la formule passe-partout en usage, a radicalement perdu le sens de l’icône et de l’iconique. Le règne de l’esthétique et de la « culture » a validé cette disparition. Et c’est précisément dans le champ de « l’Image » que l’Occident a peu à peu perdu de vue l’essentiel ; il s’agirait de penser à partir de cette perte de l’icône la catastrophe historique et quotidienne de l’image occidentale aujourd’hui. Cela dit, l’Orient et l’orthodoxie elle-même ne sont pas indemnes. À bien des égards. Je me contenterai d’avancer, avec prudence et modestie, qu’il y a aussi une réduction de la puissance de l’icône dans l’orthodoxie moderne, parce que s’est développée une « culture » de l’icône qui travestit partiellement ou fait déchoir son sens profond : il y a parfois, dans la peinture et dans l’usage liturgique privé, une dérive « saint-sulpicienne », un peu miséricordieuse, un peu folkloriste aussi. Je n’entends pas ici la foi naïve, toujours pure et très émouvante. Je parle de la dérive vers le kitsch et le fétichisme, qui éloigne de la vérité spirituelle de l’expérience iconique. Pour autant, et malgré tout, c’est bien de ce côté-ci du christianisme que demeure la source et la ressource magnifique d’une telle expérience, et l’orthodoxie en ce sens est pour moi la voie indispensable.
L’eikôn est donc ce mot grec dont Platon a fait un concept, notamment dans le dialogue Phèdre, concept qui a été transmis, via la pensée de Plotin, au christianisme des Pères grecs, puis au christianisme orthodoxe. La métamorphose qui s’est opérée au fil des siècles a été décisive pour le christianisme oriental, lequel a fait de l’icône le cœur de son approche de Dieu. La dimension iconique, qui baigne l’orthodoxie et lui donne sa grandeur, est originairement, et en son principe, une dimension qui précède toute théologie. Au point, j’y insiste aussi, que le grand art laïc a pu et peut être iconique, parfois même plus radicalement iconique que ce qui relève de la seule « religiosité».
Le terme grec « eikôn » paraît de la même famille que le verbe « eikein », qu’on trouve déjà chez Homère, et qui signifie : « Se retirer devant quelqu’un ou quelque chose pour lui céder le pas et lui laisser la place, en marque d’honneur. » Se retirer devant ce qui apparaît, c’est peut-être ce que nous dit secrètement le grec eikon. Ce serait là le sens inaugural de l’iconique, dans notre rapport avec l’être. Peut-être ce rapport présuppose-t-il en effet un retrait devant ce qui est, afin que ce qui est puisse se manifester en tant que tel. Ainsi, loin de signifier « image », loin d’être une représentation, l’icône serait le principe nécessaire à toute manifestation : elle serait l’espacement laissant la place à toute manière de présentation.
Il s’agit donc de maintenir l’icône comme un principe originaire, non comme une fausse monnaie. Loin de toute visualité, sa radicalité est d’être cette ouverture qui fait place vacante, qui vide ou évide un lieu pour mieux laisser être. L’icône n’est donc rien, ou plutôt elle est — positivement — rien. Elle est le rien qui ouvre à l’être de ce qui est. La grandeur théologique de l’icône repose, elle aussi, sur cette distance à l’égard du voir (privilégié par l’eidétique platonisante) et de son immédiateté prétendue. On peut rappeler trois de ses présupposés : l’icône réclame à la fois un prototype, une vision et un rapport avec la mort. Le négatif est bien ici à l’œuvre, puisque le prototype est sans figure (Platon le dit déjà dans Phèdre), puisque la vision relève d’un champ qui précède le plan du visible et de l’invisible, enfin parce que le mort est présence et absence, selon le principe de la relique, qui fait apparaître le mort à la fois ici et là-bas. L’iconique, c’est l’ouverture temporelle au négatif, dont le mortel est le seuil et le sens. Et c’est donc sans doute parce qu’elle est originairement un tel principe que l’icône est devenue, avec l’Incarnation christique, la figure insigne du rapport entre Dieu et l’homme dans le christianisme orthodoxe – étant entendu cependant, j’y insiste encore, que l’icône peut être envisagée comme un principe qui transcende toute théologie ; et qu’elle doit être saisie au-delà de la seule peinture : l’icône, en effet, peut être tout autant l’apanage de la sculpture, de l’architecture, de la poésie même. Ainsi, le modèle du monastère de Moldavie, conçu par Petru Rareş, m’est immédiatement apparu comme l’icône de la manifestation divine.
C’est encore dans cette dimension de l’icône que peut rayonner l’énergie, comme source de toute divinisation. Et c’est bien là la deuxième différence radicale entre les deux christianismes. L’Occident a choisi la voie de l’essence, sur la base d’une lecture réductrice et de Platon et d’Aristote, lecture néoplatonicienne et latinisante. L’Orient a préféré la voie de l’energeia (le mot est encore grec, mais surtout d’Aristote, un Aristote ignoré de la scolastique et même de la philosophie classique : l’être saisi comme energeia est pourtant au centre de cette pensée, mais je ne peux développer ici).
Icône et énergie, voilà ce qui dessine pour moi le chemin de la vérité de l’orthodoxie. Elle permet de penser, à partir de l’idée grecque de « manifestation », la relation de spiritualisation, de divinisation, de déification de l’homme, sans qu’on ait besoin des ressorts conceptuels tortueux de l’analogie, de la ressemblance et du simulacre. Elle permet tout autant de donner enfin corps en l’homme à la vérité oubliée d’une aisthesis, d’une dimension « sensible », ou « intuitive », qui soit directement en prise sur la manifestation elle-même. Tel est le « cœur », dont le grand Jean Gerson, au Moyen Âge, avait dit : « Et parlerez des six sens, cinq dehors et un dedans, qui est le cœur. » La simplification philosophique moderne a réduit l’affaire à la question sempiternelle, néoplatonicienne encore, de l’âme et du corps. Le cœur a disparu, sinon dans son usage romantique ou charitable. Lorsque Baudelaire lui-même parle poétiquement du cœur (« mis à nu »), c’est précisément dans un sens que l’Occident n’est plus capable d’entendre. Ce cœur me paraît décisif dans l’orthodoxie, notamment pour « la voie de « l’hésychasme » – titre d’un petit livre précieux du Père Marc-Antoine, qui précise combien l’intuition, accompagnée du cœur, précède toute pensée et constitue une connaissance véritable. Décisif encore le cœur quand on découvre la manière dont agit la présence de ceux qu’on appelle « les grands spirituels ».
Voilà donc, juste esquissée, la dimension qui me paraît primordiale dans l’orthodoxie. Cette importance de la place de la « manifestation » change décisivement la donne, non seulement dans la théologie, mais tout autant dans la philosophie, et dans l’art lui-même. Car même si « on » l’ignore en Occident, la pensée, la poésie, l’art véritable lui-même, autant que la foi, œuvrent dans cette dimension. L’icône est la voie royale de toute création. Et de toute libre création. Voilà en tout cas un chemin qui m’a permis de mieux mesurer les limites de l’augustinisme, de donner plus de profondeur à mon propre travail de relecture incessante et de retraduction de la pensée grecque, mais qui m’a permis aussi, soit dit en passant, de mieux marquer les insuffisances du discours assez répandu sur la théologie négative et sur l’apophase, dont se repaît aujourd’hui une certaine philosophie occidentale, laquelle tend à se donner des airs…
3/ Selon vous, qu’apporte l’orthodoxie d’important quant à la manière de vivre ?
Voilà en effet l’un des points sur lesquels se fait concrètement une différence. La manière de vivre découle – ou devrait découler – de cette dimension iconique et de cette voie du cœur, parce que rien n’est en principe séparé, ni dans l’homme ni dans le monde. L’icône est la vie même, en sa totalité. Elle implique notamment, comme voie du cœur, une manière de vivre l’Esprit, et de relier entre elles toutes les formes de connaissance, la connaissance et la prière, la connaissance et la responsabilité, donc d’engager la responsabilité active de la vie.
L’Occident se meurt des dichotomies (d’origine philosophique) qui sont autant de simplifications et d’impasses. La rationalité, et l’intellectualité, notamment en France, ont occupé toute la place, au point que même ceux qui en mesurent les limites sont pris au piège des dualismes. Le catholicisme n’a pas réussi à surmonter ces verrouillages conceptuels, et n’a pas su dépasser les débats scolastiques et même scolaires sur « sensible et intelligible », « corps et âme », « foi et savoir » etc. Même l’âme fait problème dans le discours catholique d’aujourd’hui, au point souvent d’apparaître presque comme un mot tabou, c’est bien le comble !
La manière de vivre, pénétrée de la foi orthodoxe, que j’ai pu découvrir chez tant d’êtres rencontrés, est directement celle du lien entre les différents plans et elle est marquée par le rayonnement de la présence en son accomplissement (l’energeia d’Aristote !). L’Occident aurait besoin de cette métanoia – conversion de l’esprit et du cœur – où la présence de Dieu transparaît dans tous les aspects de la vie, sans pour autant relever d’une dévotion ou d’une mysticité abstraite. C’est une présence irradiante à laquelle la vie est redevable : parce que tout est susceptible d’être transfiguré, divinisé, exhaussé. Mais dans le sens d’une extrême simplicité. Et je note d’ailleurs que même pour l’orthodoxie il a fallu un homme comme le Père Staniloae pour ramener admirablement la théologie à ces exigences fondamentales du cœur et de la vie, en la réorientant sur « l’accomplissement » (la plérophoria). Preuve que cet aspect n’est pas si simple à mettre en œuvre, et que la théologie court toujours le risque de la déliaison, par abstraction scolastique. Grâce à l’enseignement du Père Staniloae, mais aussi grâce aux Roumains eux-mêmes, j’ai mieux compris le sens de la prière, de la « prière du cœur » précisément, entendue à la fois comme pratique quotidienne, comme pratique spécifique (selon telle situation donnée) et comme mode authentique de connaissance. Et Staniloae donne merveilleusement à entendre aussi combien l’expérience de la Trinité est affaire quotidienne ; l’être que nous sommes à chaque instant est à l’image de la Trinité : « je-tu-il ».
En ce sens, comme l’enseigne encore Staniloae, l’événement majeur de la vie, c’est la rencontre : parce que c’est le Christ qu’on rencontre en chaque être. À cet égard, je me pose la question de la manière dont l’orthodoxie entend le mot « amour » dans le christianisme. J’ai depuis longtemps la conviction que le catholicisme n’a pas été très fort sur ce point capital, et si proclamé pourtant, de la doctrine de « l’amour » (amour de Dieu pour l’homme, amour de l’homme pour son prochain et pour lui-même etc.). Je crois que la Charité n’est pas vécue de la même façon dans les deux Églises, mais je ne suis pas sûr non plus que tout ait été parfaitement éclairé sur le plan doctrinal chez les uns et chez les autres. La question est d’ailleurs aussi bien celle de la philosophie que celle de la théologie, car toute la difficulté naît d’une première confusion issue de la traduction du verbe grec philein par « aimer » – alors que la philia grecque est infiniment plus riche de sens et de nuances – et d’une seconde confusion issue du fait qu’on traduit par le même verbe « aimer » le mot agapein – qui, lui aussi, a un sens complexe. Bref, la richesse et les nuances des termes sont noyées dans le seul mot d’« amour », qui a le tort de vouloir trop dire et de s’appliquer indistinctement à trop de cas différents. Certes, l’élection de l’agapè est chrétienne, on le sait, mais on ne doit pas oublier que philein est aussi souvent employé. Dans l’Évangile de Jean, par exemple quand le Christ se manifeste aux Apôtres à Tibériade et qu’il demande à trois reprises à Pierre « s’il l’aime », saint Jean utilise deux fois philein et une fois agapein : est-ce simplement synonyme ? J’entends en effet dans le philein, dans la philia une « amicalité » qui, au sens de Sophocle et d’Aristote déjà, définit la puissance du lien de communauté. Je pense que ce sens du commun (le comme-Un) est le véritable horizon de ce que le christianisme appelle « l’amour », et je perçois, quant à moi, même si c’est encore impensé, que ce sens de la communauté est beaucoup plus présent dans « l’amour » tel que le vit la pratique orthodoxe. Peut-être vais-je trop loin, et que je m’aveugle dans mon souci de compréhension originairement grecque des termes et des choses ! Je persiste pourtant : il y a bien une réalité vécue du lien et du commun qui me paraît très présent dans l’orthodoxie, quand je vois le Père Berbecaru agissant dans son village de Botiza, quand je vois combien le sens de la beauté participe de l’amour vécu pour le monde et pour la création divine chez mes amis artistes de Bucarest. Le sens iconique de la beauté incarnée et vivante est aussi « amour ». Ce que manifeste pour moi la sculpture des artistes roumains, tels Gorduz et Silvia Radu. J’en dirais tout autant de l’amour que les Roumains ont pour leur pays, de la conscience qu’ils ont que leur pays est encore animé d’une foi puissante : l’amour de Dieu est aussi amour du natal. C’est une manière si rare de vivre aujourd’hui. Nous y reviendrons plus loin.
Cela dit, et voici qui reste encore pour moi une interrogation critique, ce sens de la vie et du lien iconique impliquerait aussi la nécessité d’agir dans le monde. Je sens qu’il y a une difficulté réelle avec le sens de l’action chrétienne, laquelle a connu beaucoup d’échecs, a rencontré beaucoup d’impasses et a suscité beaucoup de malentendus. Certes, le christianisme n’est pas un humanisme, pour paraphraser le titre d’un (mauvais) livre de philosophie, car le christianisme suppose que l’homme soit transcendant à lui-même. Néanmoins, la divinisation de l’homme implique que l’homme soit plus et mieux homme dans ce monde, précisément aussi dans le lien de communauté (sociale et politique), qui traverse toute la création. Il ne s’agit pas seulement de charité, mais de respect de la création et d’embellissement dans et par tout ce qui de Dieu s’incarne. Il me semble que l’avenir du monde prochain exigera du christianisme, et de l’orthodoxie par conséquent, qu’il affronte de manière neuve cette dimension que je qualifierai d’éthique. Mais nous voici déjà au seuil de la question suivante.
4/ Une éthique orthodoxe est-elle possible d’après vous, et si oui quel sens lui donneriez-vous ?
Question difficile, et un peu périlleuse. Tout dépend ici du sens que l’on donne au mot « éthique ». Là encore, il faut repartir du sens grec, pour faire la distinction entre l’éthique et la morale. Le point est d’autant plus important que, même si l’on parle beaucoup de morale chrétienne dans le catholicisme, il ne devrait pas y avoir de morale dans le christianisme, et a fortiori dans le christianisme orthodoxe – sinon bien sûr le respect des codes de la morale la plus généralement humaine. L’éthique n’obéit pas à des prescriptions, mais à une exigence plus haute.
À la source de l’éthique, il y a l’èthos, tel qu’il est défini par Aristote dans l’Éthique à Nicomaque à son plus haut degré : l’èthos se réfère au séjour des hommes et à l’organisation du lien de communauté qui les unit. Ainsi, l’èthos est aussi l’oikos. Il n’y a, pourrait-on dire, d’économie qu’éthique, et d’éthique qu’économique. Le christianisme doit faire face à cela. D’un point de vue chrétien, l’éthique serait le plan de l’économie de la relation entre les hommes, tandis que l’ « iconomie », elle, situe le plan de la relation verticale entre Dieu et les hommes. C’est une croix. C’est la croix que dessine l’intersection de ces deux plans de « l’iconomique » et de « l’économique ». Et c’est une croix douloureuse, en un double sens : 1/au sens où l’on dit en français, à propos d’un nœud de difficultés, que c’est une croix, et 2/bien sûr, au sens de la souffrance du Christ.
Comment articuler les deux plans ? En théorie, oui, une éthique orthodoxe est non seulement possible, mais nécessaire. Aussi nécessaire que la Croix. Elle procède de l’idée même d’Incarnation. S’il est vrai que la divinisation de l’homme par sa transcendance est la réalité la plus iconique et la plus fondamentale qui soit, tout autant sa manière d’être pleinement homme dans et par sa foi passe par une éthique rigoureuse et dont les termes restent pour l’essentiel à définir pour l’avenir. Loin de tout « piétisme ». Une éthique engage un sens actif de la responsabilité du lien et de l’économie du lien. Impossible pour le chrétien de l’esquiver.
Pour moi, la pensée de l’éthique au sens d’Aristote est une richesse et une ressource, dans le christianisme même. L’éthique est celle de la philia, dont nous avons dit précédemment qu’il n’est pas stricto sensu l’amour. La philia est le préalable éthique et économique à la Charité elle-même. Même si la Charité, l’esprit de Charité a des côtés grandioses dans le catholicisme, elle est aussi incapable d’affronter la question du commun. L’Église catholique, sous la pression de l’augustinisme politique (dès le Xe/XIe siècle), a malheureusement simplifié l’articulation de la Cité de Dieu et de la Cité des hommes. Même un homme comme Pascal a buté sur la question de la Justice, comme sur une impasse. Et plus près de nous l’échec du christianisme social en Europe, dont les versions politiques ont été terriblement médiocres (notamment en Italie et en Allemagne), prouve que la voie chrétienne a tout à faire et tout à explorer de cette possibilité éthique et économique. L’orthodoxie doit, elle aussi, à mon sens, reprendre la question, d’autant que les conséquences de décennies de communisme sont aujourd’hui redoutables dans les pays où l’orthodoxie a toujours été dominante (mais c’est aussi vrai de la Grèce orthodoxe, qui est dans l’état que l’on sait, alors qu’elle n’a pas été marquée par le communisme). En ce sens, en comparaison du catholicisme occidental, l’orthodoxie pourrait être beaucoup plus à même de reprendre en main cette question de l’éthique chrétienne. Une éthique chrétienne est à l’ordre du jour et elle est affaire d’avenir : je penserais volontiers, en effet, que les structures « économiques » d’aujourd’hui, en voie d’implosion, sont appelées à se transformer ; pas demain, certes, et nul ne sait encore comment, mais il est probable que de nouvelles formes apparaîtront dans lesquelles la force du commun aura un rôle inédit, et on peut souhaiter alors que le christianisme, tel que l’orthodoxie l’incarne, soit un moteur spirituel de cette transformation – il faut commencer à le penser, sans verser dans l’utopie bien sûr, mais en termes d’éthique…
Votre question oblige ainsi à aborder deux points importants, et ils le sont particulièrement pour la Roumanie contemporaine : l’argent de la corruption et les compromis institutionnels de type politique. Sans prétendre le moins du monde donner des leçons de morale à qui que ce soit (c’est la maladie des Occidentaux, et des Français en particulier), il reste que je suis parfois troublé par la réserve prudente voire silencieuse de plusieurs de mes amis orthodoxes face à ces questions. Notamment sur la question de la corruption contemporaine. Je suis convaincu que la corruption financière est une gangrène pour une société, quelle qu’elle soit, et d’autant plus aujourd’hui que le système financier s’est autonomisé, que des sommes d’argent considérables circulent, que l’argent sale se recycle dans le système « légal », et que la corruption, donc, prétend se normaliser avec la complicité du politique. Or l’ampleur du phénomène est aujourd’hui vraiment destructrice, et à un double titre : l’emprise de la corruption est une menace pour la communauté « économique » des hommes, et une insulte à « l’Iconomie », c’est-à-dire à l’honneur de la création et à la présence de Dieu. Ce qui encourage à ce point la déchéance humaine, ce qui généralise les rapports pervertis, encouragés par la dérive maffieuse, est une ruine de l’âme, de l’esprit et des corps. Le trafic de drogue et ses conséquences, le trafic d’armes, le trafic d’êtres humains, le trafic d’organes, par exemple, entrent dans cette économie abjecte. Je ne crois pas qu’on puisse se contenter de la prière face à cette insulte à la beauté et à cette apologie de la déchéance. La responsabilité éthique du christianisme est aussi là. Quant aux compromis ou plutôt les compromissions politiques, qui sont des formes de conspirations du silence, je ne pense pas qu’elles relèvent d’un christianisme responsable. Je sais pourtant qu’il y a eu, par exemple en Roumanie, des clivages à l’intérieur de l’orthodoxie – comme il y en a eu aussi dans le catholicisme. Pour simplifier, en prenant un exemple, je dirais qu’entre le groupe du Buisson Ardent et l’Église officielle, engagée dans une relation parfois douteuse avec le pouvoir, il y a eu de singulières différences, et le renouveau spirituel qui s’est engagé en Roumanie est passé par le Buisson ardent… Ces questions devraient être abordées au sein même de l’Église, et dans une réflexion qui sache partir des fondements du christianisme, au lieu de les laisser dans l’ombre, ou dans l’oubli de l’histoire.
La question qui est à l’horizon de cette croix de la foi et de l’éthique, c’est sans doute aussi celle du Mal. Je choisis d’écrire le mot avec la dignité d’une majuscule, parce qu’il est aussi ce qui, sans paradoxe, nous relie à la transcendance et à notre surnature (Baudelaire est l’un de ceux qui l’a le mieux compris). Que ce soit du côté catholique ou du côté orthodoxe, je trouve que le Mal demeure un point obscur, et cependant névralgique. Du côté du catholicisme, la culpabilité augustinienne, marquée par l’invention du péché originel, a handicapé l’approche phénoménologique du Mal, en simplifiant définitivement la question et la réponse – au point qu’aujourd’hui l’Église catholique ne sait plus trop comment s’en sortir d’un point de vue théologique, et qu’elle préfère même ne plus parler de rien, ni du Mal ni du diable ni de rien… Mais, du côté de l’Église orthodoxe, on dirait que l’absence du péché originel (et il importe en effet, avec Romanides, de bien faire la différence entre le péché originel et ce qu’il appelle le péché ancestral) crée le défaut inverse : comme si le mal était secondaire et comme si, en tout cas, il n’était pas à prendre en compte à un échelon éthique. Ce qui revient au même résultat que le catholicisme, par la voie opposée ! J’ai certes constaté que l’orthodoxie, mieux que le catholicisme, gardait un sens du diabolique, mais l’idée en demeure encore très diffuse, bien vague, et ne s’articule pas sur l’effort de penser la réalité du Mal dans sa multiplicité. Cela dit, l’honnêteté oblige de reconnaître que la philosophie elle-même, et plus que jamais, reste en rade sur cette question, qu’elle effleure parfois sans jamais pouvoir se l’approprier. Mettre en chantier une pensée du Mal, dans la perspective d’un monde contemporain, serait une forte entreprise philosophique autant que théologique, à la hauteur de l’exigence du christianisme de l’avenir et d’une éthique possible.
5/ Quelle serait votre compréhension philosophique de la manière dont l’orthodoxie conçoit le sens de la vie ?
Nous sommes là sur un point d’une grande actualité. Face à la montée en puissance de la biotechnique et de la manipulation du vivant, face à la dérive des sociétés occidentales sur cette question de la vie et de la sexualité, face aux difficultés du catholicisme à trouver les véritables réponses à cette mutation du monde, l’orthodoxie pourrait offrir au christianisme les fondements d’une doctrine claire et assurée. Le sens de la vie s’y décline, je crois, de manières multiples. On pourrait dire simplement que la Vie consiste en trois dimensions réunies et imbriquées : la première, c’est celle de ce qu’on nomme aujourd’hui le vivant ; la seconde, c’est celle que les Grecs appelaient la psychè (qui est devenue restrictivement « l’âme » avec la philosophie de Platon) ; la troisième, c’est celle qui nous lie à la mort et à la Résurrection.
Il y a d’abord un sens orthodoxe de l’unité du vivant. Mais pas au sens du matérialisme ! L’unité du vivant, c’est le sens de la création divine – et l’animal est impliqué dans cette unité. Le vivant exige sa compréhension, parce qu’il est sens. Mais la vie ? Le grec, là encore, est précieux, car il disposait de deux termes : bios et zoon. Pourquoi repartir de ces deux termes, dont le sens d’ailleurs est assez variable et nuancé en grec ancien ? Parce qu’il nous permet d’affirmer que le matérialisme philosophique et scientifique – c’est-à-dire le positivisme – a imposé l’idée que la vie est d’abord affaire de biologie. Certes, mais c’est une biologie qui est en fait une zoologie ! Le positivisme scientiste s’est imposé de manière si redoutable que cette approche paraît « naturelle ». Elle ne l’est pas. Même les Grecs, qui ne disposaient pas du christianisme, avaient un sens étonnant de la vie, et ne considéraient pas qu’il y aurait eu une « nature » humaine. Le bios ne relève pas d’une nature, mais d’une surnature. En ce sens, les Pères grecs de l’Église ont été étonnamment plus grecs que platoniciens !
Si l’orthodoxie est restée à bien des titres proche de ces Pères, alors elle est une ressource pour penser le vivant et son sens. Les textes des Pères en effet sont d’une surprenante richesse de questionnement, au regard de la pauvreté de nos distinctions héritées d’une pétition de platonisme, notamment sur le dualisme du corps et de l’âme, et sur l’immortalité de l’âme. Saint Grégoire de Nysse, par exemple, propose une anthropologie chrétienne de haute volée, pour ce qui touche à la question de l’unité de l’âme et du corps. L’âme veut dire vie. Et l’homme à naître est en puissance. Je ne peux ouvrir ici le débat trop complexe qui anime nos sociétés sur la question de la sexualité et du mariage, mais il est évident que c’est aussi du côté de la surnature, telle qu’elle est au fondement de l’humain, qu’il faut aller chercher le sens de la distinction de l’homme et de la femme, et celui de leur union dans le mariage.
Les riches perspectives ouvertes par la pensée des Pères font écho pour moi à ce que les Grecs d’avant Platon appelaient la psychè. La psychè n’était pas l’âme, mais la vie, le souffle de vie, qui touchait autant ce que nous appelons l’âme et le corps. Je rappellerai qu’en grec il n’y a pas de mot pour dire le corps, ou qu’en tout cas le mot que Platon choisit pour dire le corps, tel qu’il va être habité par l’âme, est en fait le mot grec de sôma, qui veut dire « cadavre »… La réduction platonicienne est l’invention de l’âme sur fond de cadavre, c’est-à-dire aussi le début de tous les problèmes philosophiques et théologiques, aussi tordus qu’irrésolus quant à l’union de l’âme et du corps. À cet égard, l’influence du platonisme demeure chez saint Augustin – lui qui pourtant a voulu se défaire des néoplatoniciens – lorsqu’il affecte la culpabilité à l’ordre des corps. Le corps cadavre, mortel, habité par l’âme immortelle : jamais les Grecs avant Platon n’avaient eu une idée aussi saugrenue ! Saint Grégoire de Nysse avait bien compris qu’il fallait prendre autrement le sens profond de la vie, à hauteur de la psychè : ainsi, il n’y a pas pour lui de dualisme, pas de préexistence ni de post-existence de l’âme ; et il y a dans la semence embryonnaire tous les traits de l’homme « en puissance » : Dieu a créé la Vie, l’homme la transmet, comme âme et corps réunis toujours, s’il faut garder ces deux termes.
Le sens de la vie, c’est aussi le sens de la psychè, au plus loin de ce qu’en pense ce qui s’est assez malheureusement imposé comme « psychologie ». L’ignorance radicale du sens profond de la vie comme psychè conduit désormais à l’effondrement psychique de l’Occident – et corollairement à la floraison du « psychologique », parfois à la limite de l’imposture. On connaît l’explosion des addictions de toutes sortes, leur emprise terrible sur la psychè de nos contemporains : c’est une épidémie d’autant plus redoutable que la médecine reste désemparée et que la psychiatrie est elle-même en train de s’effondrer dans sa théorie comme dans sa pratique. Pire : la médecine elle-même contribue au phénomène puisque je compte aussi au nombre de ces addictions celles qui sont de nature pharmacologique, tels les antidépresseurs, les anxiolytiques et autres somnifères qui deviennent « notre pain quotidien ». Cet effondrement psychique est l’effondrement du sens de la vie. Or le catholicisme n’a pas de réponse à cette situation effarante. Le christianisme doit impérativement reprendre en main la question, c’est une urgence « vitale », et là encore la Patristique a ouvert des voies tout à fait surprenantes et originales, ignorées de la réflexion moderne. Jean-Claude Larchet, en France, a fait sur cette question un travail de recherche fort précieux, qui permet de mesurer la subtilité et la pertinence de la pensée des Pères de l’Orient chrétien, du 1er au XIVe siècle. L’approche de la dimension psychique et de la question toujours abyssale de la folie gagnerait à repartir de leurs textes majeurs.
Enfin dernier sens de la vie, qui est aussi le premier, et qui participe du sens des deux précédents : c’est celui qui nous habite dans notre relation primordiale à la mort et à la Résurrection. Il est déjà, selon moi, le sens grec de la finitude chez les « mortels » que nous sommes, qui engage tout à la fois au respect de la mort, au respect de la limite (humilité) et à l’ouverture au sens superlatif de la vie. J’irais vite là-dessus, mais il faudrait développer. On peut constater que l’Occident vit désormais l’abandon du sens du deuil, du sens du rite funéraire. La différence est immense entre Occident et Orient sur ce terrain. Au fil des siècles, sous l’influence du protestantisme, puis de l’athéisme idéologiquement actif, qui dénient toute sacralité au corps (il y a souvent plus de sacralité du corps et du sens de la mort et du deuil chez les peuples qui n’ont pas connu le christianisme !), nos sociétés deviennent incapables d’honorer les morts et d’affronter le deuil des êtres chers. Il faudrait ici parler du développement de l’incinération (à distinguer d’ailleurs de la crémation). Quelle différence avec les pratiques de la tradition orthodoxe ! La crise du sens de la vie (biologique, psychique), c’est aussi cet effondrement du rapport de la vie avec la mort. L’enjeu majeur, c’est évidemment de penser la vie à la lumière de la Résurrection. J’aime cette pensée de Michel-Ange : « L’argile, c’est la vie ; le plâtre, c’est la mort ; le marbre, c’est la Résurrection. »
6/ Croyez-vous qu’on puisse discuter d’un rapport entre orthodoxie et philosophie ? Si oui, comment caractériseriez-vous les racines philosophiques de l’orthodoxie ?
Oui sans aucun doute, mais la difficulté commence avec le sens que vous donnez au mot « philosophie » ! Et corollairement au mot « théologie »… Le travail à entreprendre me paraît à la fois immense et essentiel. Parce que la difficulté tient d’abord au fait que christianisme et théologie sont déjà pénétrés par trop de philosophie – au-delà même de ce qui est connu sous le nom de « scolastique ». Personnellement, je souhaiterais que soit enfin et d’emblée admise et légitime la distinction entre philosophie et pensée (mais c’est loin d’être acquis !). Cette distinction a été le sens de l’entreprise de Heidegger, mais ses enjeux et ses conséquences ne sont pas véritablement entrés encore dans les esprits – qu’on puisse ainsi encore parler de « la philosophie de Heidegger », en développant toute une nouvelle scolastique universitaire à son propos, est très révélateur. À la différence de la philosophie stricto sensu, la pensée, elle, ne relève plus de l’onto-théologie ; et elle engage du même coup un tout autre regard sur la philosophie elle-même, sur sa tradition et sur sa relation à la foi autant qu’à la théologie. Or nous sommes encore très loin du compte.
Quand je dis que le christianisme est déjà pénétré de philosophie, jusque dans sa vulgate, c’est évidemment vrai du catholicisme tel qu’on me l’a enseigné, tel que je l’ai pratiqué, et tel que j’ai pu aussi, un jour, douter de son institution. Il ne s’agit pas de dénoncer une tradition, mais de mesurer, en toute herméneutique, quel a été l’impact, d’une puissance inouïe, de plusieurs événements cumulés : d’abord la traduction en grec de l’Ancien Testament (Les Septantes), puis une certaine lecture de Platon et d’Aristote, dont les concepts et les notions, sous forme latinisée, passent au christianisme puis à la pensée scolastique médiévale. La philosophie, en ce sens, est partiellement en cause dans le développement d’un dogmatisme, voire d’un fondamentalisme, qui nous a poursuivis jusqu’à aujourd’hui.
Si le christianisme veut rester vivant comme pensée, et il le doit, il faut le nourrir d’une pensée qui sache être active et en métamorphose dans sa lecture de la tradition et de la lettre. Mais l’exigence est la même pour la philosophie. Autrement dit, christianisme et philosophie doivent être l’un et l’autre capables de la même ouverture pour se déprendre, se dégager radicalement de la métaphysique – laquelle n’est tout de même pas « de toute éternité ». Ainsi, côté philosophique, la lecture de Platon et d’Aristote n’est pas définitivement close, bien au contraire, et retraduire certains textes révèlent souvent des surprises, qui peuvent être riches d’implications pour une théologie renouvelée – chez Platon, comme j’y ai fait allusion précédemment, ce qui se découvre dans Phèdre du côté de la « manifestation » et de ce qu’il nomme l’eikôn, reste un chapitre « oublié » par la tradition, privilégiant l’Idée et l’essence ; chez Aristote, c’est la pensée de l’energeia qui reste encore trop sous-estimée. Inversement, du côté théologique, il faudrait approfondir les racines et les implications de l’identification de Dieu et de l’être, il faudrait réfléchir sur le sens profond du négatif, il faudrait dégager où se situe la grandeur oubliée d’un certain Moyen Âge, et la liste est largement ouverte (je ne reviens pas sur les questions entrevues précédemment de la vie, de l’éthique etc.)
Paradoxalement, donc, ce n’est pas en faisant de la philosophie et de la théologie les servantes de l’une ou de l’autre que pourra naître un chemin. Et je ne suis pas toujours sûr non plus que ce qui naît chez tel auteur fort respectable comme Yanaras – recourant à une certaine lecture de Heidegger et revendiquant une méthode « philosophique » pour créer une sorte de théologie néoorthodoxe – soit la clef de l’ouverture dont je souhaite qu’elle advienne au bénéfice de l’une et de l’autre, c’est-à-dire de la foi comme de la pensée (et non plus de la théologie et de la philosophie).
Pour la foi et pour la pensée, qui doivent rester sur leur terrain propre (Heidegger le dit fort bien), mais sans pour autant s’ignorer bien sûr, tout doit être affaire d’expérience. Une expérience qu’on pourrait dire « phénoménologique », si le terme doit signifier que la pierre de touche est le phénomène, le phainomai en sa manifestation – à commencer par celle de Dieu même. C’est à cette source commune et à ce même esprit que « théologie » et « philosophie » (si je garde vos deux catégories) doivent puiser, tout en gardant leur autonomie. Et pour ce qu’il m’a été donné de connaître, du côté de l’orthodoxie, je pense très important, et pour tout dire exemplaire, le travail d’un Florovsky (Les Voies de la théologie russe), qui montre précisément la pénétration de la philosophie et de la théologie occidentales dans le champ de l’orthodoxie russe ; de même, la pensée de saint Justin Popovic (dans le sillage de saint Nicolas Velimirovic), le travail du Père Romanides, et bien sûr l’œuvre immense du Père Staniloae – à commencer par sa colossale traduction en roumain de la Philocalie. Là, le travail de la pensée s’effectue dans l’esprit herméneutique dont je parle. Il n’est pas toujours bien accepté, comme il arrive souvent, mais tel est aussi le destin bien connu de la pensée si elle est fidèle à sa tâche, qu’elle soit « philosophique » ou « théologique ». Je suis sûr que d’autres « horribles travailleurs » (Rimbaud) apparaîtront ici et là sans tarder, parce que la voie est plus libre que jamais.
Pour la pensée comme pour la foi, pour la théologie comme pour la philosophie, la démarche peut être commune quand on évoque le chemin qui mène de la purification à l’illumination et jusqu’à ce que le cœur s’ouvre alors à la manifestation, dans une manière de simplicité et de quotidienneté. Et de responsabilité. Il y a là le chemin d’une spiritualité, qui se trace au contact de la Manifestation, de l’Énergie et du Cœur. Contre la crispation sur la métaphysique et sur les dogmes, contre la spéculation et toutes les formes de fondamentalisme, la foi fait l’expérience de ce qui se révèle et qui exige un chemin pour entrer dans une source vivante. Parménide, Héraclite, Socrate, les Pères de l’Église, et tant d’autres encore avaient éminemment ce sens aigu de la présence dans la manifestation. Et les Apôtres, lors de la Pentecôte, témoignent de la puissance de l’iconique, laquelle devient alors l’affaire de toute une existence.
7/ Connaissez-vous la spiritualité orthodoxe roumaine ? Et si oui, pourriez-vous évoquer ce sujet ?
Connaissance, je n’oserais dire, mais découverte assurément, avec joie, et admiration. Découverte que j’ai pu faire au fil de mes voyages et de mes conversations.
Un mot d’abord sur la question elle-même. Qu’il y ait une orthodoxie roumaine, différente de l’orthodoxie russe, grecque, ou encore serbe, est un fait que l’Occident et les catholiques ignorent en général, sauf quelques spécialistes. Que l’absence de Papauté puisse conduire à une spécificité nationale des Églises orthodoxes est évidemment une bizarrerie aux yeux des Occidentaux. Pour autant, cette réalité ne doit pas être mésinterprétée, et, je l’ai compris, au sein même de l’orthodoxie. Dans le sillage du Père Placide Deseille, Felicia Dumas insiste, comme elle me l’a expliqué, sur le risque du « phylétisme » : il est nécessaire que, même particulières, les Églises veillent à se considérer dans leur rapport d’appartenance à l’Église une et universelle, dont l’unité de l’Église orthodoxe est une émanation. Il faut échapper au risque du particularisme et du sectarisme. C’est d’une forte évidence.
Pour autant, l’individualisation des Églises en orthodoxie leur donne un charme, une beauté et une présence tout à fait extraordinaire, et c’est bien là, selon moi, ce qui caractérise en particulier l’Église de Roumanie. Nous touchons ici à l’urgente question de ce que Simone Weil nomme le « déracinement », phénomène dont l’acuité est devenue instante depuis quelques décennies, au point de constituer une interrogation centrale quant au devenir de l’homme à venir (la question des « migrants », qui occupe tant les médias européens, touche bien sûr à cette dimension). Le déracinement est une réalité douloureuse, énigmatique aussi dans nombre de ses aspects philosophiques, mais l’enracinement ne se décrète pas pour autant, dans la mesure aussi où il peut devenir une revendication suspecte, qui donne lieu à des méprises, à des malentendus, à des manipulations et souvent à des excès dont le nationalisme est coutumier, dans des versions toujours renouvelées.
La chance, la grâce, la vertu et l’énergie de l’orthodoxie roumaine, c’est d’être encore assez « enracinée », sans avoir été contaminée par trop de folklore. L’Occident, et notamment en France, est pris dans la dichotomie de l’universalisme et du régionalisme. Les partisans des « régions » sont tombés le plus souvent dans une pauvre folklorisation, et leurs adversaires ont beau jeu de considérer qu’ils ne représentent qu’une régression archaïque. La Roumanie, elle, échappe pour l’essentiel à cette malheureuse impasse. Elle n’est pas un régionalisme. La Roumanie, c’est encore au sens fort, un peuple. Parce qu’elle a une langue commune, une religion commune, une foi commune, qui vivent d’une âme commune. Bref une spiritualité commune. Et ma fréquentation des Roumains me permet aussi de mesurer combien cette spiritualité diffère de celle des Russes ou des Grecs, tels que je les connais du moins.
Il y a souvent chez les Roumains une sensibilité, une mesure, une douceur, un sens que je rapprocherais de ce que les Grecs anciens appelaient l’aidôs. Qui est une douceur spirituelle, celle qu’on découvre sur le visage de certains religieux et dont on dit qu’elle était la marque du Père Païssié Olaru et du Père Staniloae. Il y a aussi souvent une gaieté, gardée jusque dans les épreuves, le sens de la joie, de la danse et de la fête, qui respire de manière lumineuse dans les campagnes. Tout cela est connu et m’a frappé, comme d’autres avant moi. Mais on ne doit pas non plus se limiter à l’éloge anthropologique de la ruralité et du village, quelle que soit leur beauté. Le village, c’est surtout une incarnation de la communauté spirituelle, telle que je l’ai vue fonctionner dans le Maramureş, en Moldavie ou à Lupşa. C’est une communauté qui n’est pas archaïque, parce qu’elle est aussi très contemporaine dans sa manière de vivre et parce que son unité vivante est tenue dans et par la foi. C’est un cas peut-être unique dans l’Europe chrétienne. À Breb (Maramureş), par exemple, j’ai eu la surprise de voir après la liturgie dominicale l’essentiel du village rassemblé dans la cour de l’église pour discuter de quelques questions municipales. Chacun donnait son avis en participant à l’élaboration d’une solution. J’avais devant moi une agora tout à fait étonnante, celle de la communauté villageoise à l’ombre du clocher de l’église. Et on pressent que la communauté véritable est aussi celle qui unit la maison villageoise et l’église : il y a une porosité, un échange vivant, une osmose étonnante entre elles deux, qui les nourrit réciproquement.
S’agissant encore de cette communauté spirituelle, il faut dire ici la présence magnifique des monastères dans toute la Roumanie, qui impressionnent par leur force d’attraction. Les monastères orthodoxes, bien plus et bien autrement que ceux de la tradition occidentale, sont ouverts sur les villages de l’alentour ; ils ont un rayonnement que permet aussi la proximité des moines ou des nonnes avec le peuple. Et il est immédiatement sensible que le monastère, avec au centre l’église, appartient aux racines majeures de ce pays – et je crois savoir que le monachisme s’est beaucoup développé en Roumanie après 1990.
Je me permets de citer sur ce point un peu longuement une partie du texte que j’ai publié dans la revue Apostolia (juin 2012), pour rendre compte de mon pèlerinage à Lupşa. Après avoir évoqué l’étrange moment que j’avais ressentis d’une poussée collective invisible, j’écrivais : « Dieu est là, alors que nous, nous ne sommes pas toujours présents. C’est ce sentiment de l’être là, dans l’ouverture à l’événement d’une présence partagée et dans l’expérience absolument nécessaire d’une communauté, que m’a donné le moment d’apothéose du pèlerinage. L’événement, c’est l’appartenance. Appartenance multiple : celle de la personne à un groupe, appartenance à l’ensemble des fidèles d’un village et à la communauté du monastère qui l’a accueilli jusqu’à nous donner de partager le repas des moines, le dimanche de Pâques ; appartenance aussi à la communauté que ce monastère forme avec les monastères voisins, dont moines et moniales nous accueillant nous ont frappés par leur jeunesse ; appartenance encore aux plus vastes ensembles de la région et d’un pays, plus haute encore celle qui nous unit avec l’ensemble de la communauté ecclésiale. C’était le sens grec initial du terme ekklésia : l’assemblée qui exalte chacun jusqu’à sa réalité la plus haute, et que le christianisme a su hériter pour situer le corps de l’Église christique. Quelques jours après Pâques, me trouvant à Bucarest, je racontais cette expérience à mon ami Sorin Dumitrescu, auquel je disais qu’il ne m’avait peut-être manqué que la communion à laquelle je ne pouvais prétendre. Ce qu’il sut me dire fut le couronnement de mon expérience : ”Mais si, vous l’avez eue, cette communion. Ce que vous avez vécu d’unique, c’est l’appartenance à la communauté eucharistique”… » Oui, et il fallait venir en Roumanie pour cela.
À Paris même, je mesure l’importance que l’Église roumaine orthodoxe, en retour, accorde au pays natal. J’ai appris, par exemple, que la paroisse de Romainville a créé une école, qui, à côté de la catéchèse, dispense des cours hebdomadaires de langue, de littérature roumaine et d’histoire. Il s’agit explicitement de faire connaître et d’approfondir l’histoire du peuple roumain, sa langue et sa foi ancestrale. Quarante enfants sont inscrits… Faut-il commenter ?
Tous les efforts désormais devraient être consentis pour maintenir vivante une telle communauté spirituelle, capable d’être dans ce monde d’aujourd’hui, sans renier l’ancestral et ce que Baudelaire nomme si bien notre « harmonie native ». Il faut prier surtout pour deux choses inverses, mais corollaires : il faut que les Roumains sachent ne pas défigurer par trop de démesure et de béton mal pensé l’architecture délicate et équilibrée de leurs villages et de leurs églises ; et il faut prier, à l’inverse, pour que l’enracinement spirituel ne soit pas soit pas contaminé par l’idéologie occidentale du « patrimoine » : sous prétexte de sauvegarder voire de reconstituer la couleur locale (et notamment à des fins touristiques), cette idéologie funeste accélère définitivement la perte du sens et contribue à asphyxier ce qu’elle prétend sauver. L’Église orthodoxe doit être ici en première ligne pour assurer le devenir de cette « spiritualité roumaine ».
À l’écueil du patrimoine j’ajouterai, pour clore, deux dangers qu’il ne faudrait pas non plus négliger : celui d’une Église trop autarcique, dans une Roumanie qui confondrait le national et le « nationel » (distinction que j’emprunte au poète allemand Hölderlin). D’une part, l’autarcie dans la bonne conscience est dangereuse pour l’Église elle-même, quand le pays est en proie aux difficultés qui tiennent à « l’économie » (en tous les sens), avec une classe politique de parvenus, incapable d’échapper à la corruption, et qui est capable encore de massacrer ce qu’il y a de meilleur dans l’âme de ce pays : sa spiritualité, précisément. La spiritualité doit savoir recourir à toutes les armes. La prière oui. Mais il y faut aussi l’éducation, comme le montre bien l’exemple de l’Église de Romainville. Et il y faut une éthique du discernement ; on dit qu’il ne faut pas juger ; mais cela ne signifie pas qu’on doive renoncer à tout discernement, et la spiritualité, c’est aussi avoir le sens de la responsabilité de notre divine humanité – le Christ le savait face aux marchands du temple. Quant au national, d’autre part, c’est un risque connu dans la mesure où il donne toujours lieu à des idéologies que l’histoire a condamnées et qui sont autodestructrices ; le « nationel », lui, est spirituel et poétique. La spiritualité roumaine est une spiritualité d’avenir si elle sait éviter les trois écueils énoncés, si elle sait se maintenir comme spiritualité vivante, riche, comme elle est, du sens de la beauté. Bref si elle sait qu’elle est le fondement de la dimension iconique, charimastique, christique dans laquelle s’enracine la Roumanie. Durablement, c’est une espérance. Pour nous aussi.
- Bouillon de lecture
- L’histoire et l’évolution de l’orthodoxie occidentale. Interview de Tudor Petcu avec l’archiprêtre orthodoxe Jean-François Var
- Faptă nouă la Luceafărul, primum aliena lingua. Tudor PETCU: ,,L’evolution du dialogue oecumenique apres la deuxième guerre mondiale”
- La lecture silencieuse en classe de FLE
- Interview de François Bœspflug, sur la signification spirituelle du Noël du 25 décembre
Drept de autor © 2009-2026 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania